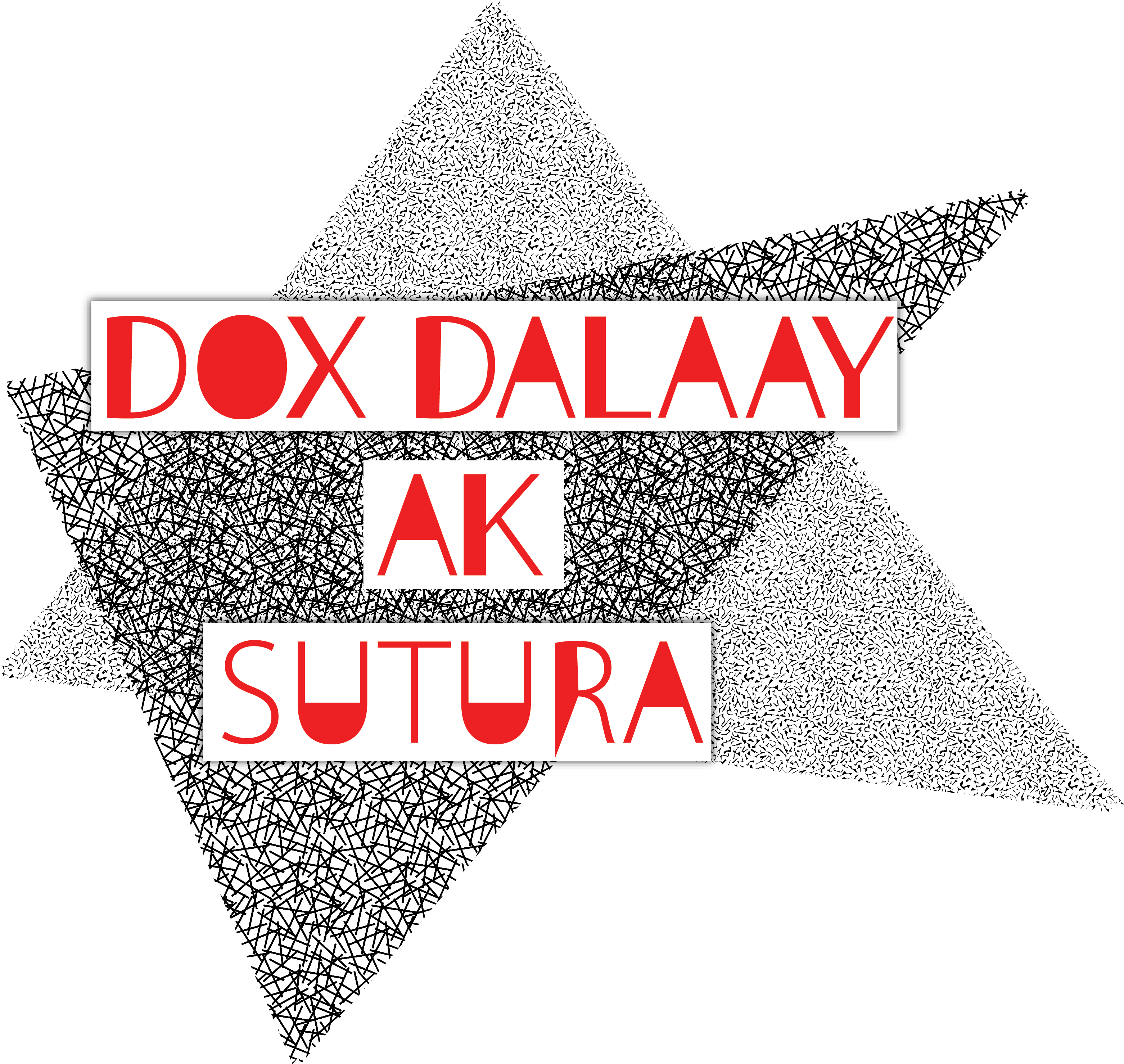REGARDS CROISES
C’est à l’occasion de nos rencontres au cours desquelles il m’enseigne la langue wolof que Babacar GUEYE me présente ses photos. Professeur passionné par sa langue et sa culture il répond volontiers avec érudition à toutes mes questions.
Grand bien lui a pris ce jour là de me montrer ses photographies que l’on peut désigner photographies de fétiches si insolites pour mon regard d’occidentale.
Ainsi, Babacar GUEYE me raconte qu’il se promène régulièrement sur la plage et trouve des fétiches rejetés par la mer. Il les photographie.
Il sait que je m’intéresse à sa culture mais comment a-t-il senti que je serais littéralement happée par ses photos ?
Elles ont tout pour me plaire ces photos. Elles représentent tout ce que j’attends d’une démarche photographique. Elles nous parlent d’un monde et d’une culture dont j’ignore presque tout. Elles nous renvoient les signes d’un mystère presque aussi épais pour lui que pour moi.
Nous sommes en territoire Lébou, à Dakar sur la presqu’ile du CAP-Vert et Babacar n’est pas Lébou.
Cette rencontre est trop belle, je vais tenter d’en dire quelque chose.
LE PROMENEUR PHOTOGRAPHE
C’est en homme libre indépendant que Babacar GUEYE a photographié ces fétiches lors de promenades sur la plage de YOFF près de chez lui. Au cours de ses flâneries, ses errances il rejoint la grande famille des photographes voyageurs attentifs aux objets à l’infiniment dérisoire.
Dérisoire … pas tout à fait… Ces objets qui hors de son regard averti peuvent être assimilés à des déchets rejetés par la mer, retiennent l’attention par leur présence mystérieuse. Il a fallu le regard averti de Babacar pour transformer ces objets quelconques en objets uniques. Une fois identifiés comme fétiches, leur allure énigmatique, innommable, les range volontiers du côté du divin. Ce qu’ils représentent, pourquoi et en quoi représentent-ils quelque chose? Le mystère demeure.
La photographie retrouve ainsi sa puissance mystérieuse et dangereuse. Peut-être faut-il ici s’en méfier comme d’un poison.
Mais il est des choses qu’elle est impuissante à dire.
La photographie perpétue une possibilité de description individuelle vis-à-vis de ces objets. Elle place ces fétiches au rang d’objets devenus éventuellement “muséifiables”.
Les photographies de Babacar GUEYE portent toutes une transfiguration du monde. Il ne s’agit pas de l’identique mais du regard du photographe. Retrouver le sens des choses à travers le regard de l’artiste comme regard parcellaire de sa société. La photographie laisse place à toute interprétation possible de ces objets.
Lors de ses flâneries Babacar GUEYE a montré avec son appareil téléphonique qu’il était possible d’interpréter le monde.
Au diable les selfies et autres cultures de l’égo comme des miroirs aux alouettes qui nous entretiennent dans une société de dupes.
Babacar nous montre que l’interaction de la prise de vue peut être autre chose qu’un vol, qu’un viol ou un autoportrait.
Ses photos portent un regard critique sur une partie du monde, de son territoire. Par le questionnement qu’elles induisent, elles peuvent être vues comme politiques. On peut se demander quelle place peut jouer Babacar comme voyeur et photographe à l’intérieur du rituel dont il est question.
Ce sont avant tout des photos de flâneur, de poète, qui invitent au dialogue et à la pensée.
Éthiques, esthétiques elles nous mènent bien au-delà de la contemplation et de la consommation des images.
Le fétiche
Babacar GUEYE va-t-il penser que, échoués ou photographiés, les fétiches allaient livrer leur secret ?
Au Sénégal, les pratiques fétichistes mystiques sont un héritage bien vivant des croyances animistes associées aux pratiques musulmanes. Cet héritage n’est pas un folklore mais un réel fait de société. Considérées comme des pratiques obscures pour les uns et une hygiène de vie pour les autres elles donnent lieu à des rituels magico-religieux et font partie intégrante du quotidien des Sénégalais. Le recours au marabout est habituel au Sénégal. Il y a le bon et le mauvais marabout, celui qui invoque le nom d’Allah et celui qui invoque les « djinées ». Les pratiques musulmanes se retrouvent dans l’animisme.
Pour accomplir sa mission l’objet fétiche devient le véhicule de rituels maîtrisés et accomplis.
Le fétiche auquel on attribue un pouvoir magique reste pour les scientifiques l’objet d’un « malentendu » entre deux civilisations, l’africaine et l’européenne. Réfuté par Marcel MAUSS, Sigmund FREUD s’en empare comme symptôme de perversion. Le choix pervers se définit ainsi : une partie du corps ou un objet sont choisis comme objet d’amour et objet d’une excitation d’ordre sexuelle. Notre propos est plutôt lié à la définition plus ancienne du fétiche daté de 1750 comme étant lié à un sortilège, un artifice.
Si l’on tient compte de la définition de Maurice Godelier* qui dit que “toute société humaine est fondée, non pas sur le système de parenté mais sur un système économique d’échange”, le fétiche vient confirmer cette affirmation.
La réponse sociale du fétiche est issue d’une demande faite au marabout en échange d’argent pour régler un problème social relationnel.
Le marabout, bénéficiaire économiquement, est dans la position hiérarchique de celui qui sait. La fonction du fétiche est une fonction de passeur au service d’une vérité. Le génie qui tient lieu d’adresse colmate le manque et représente la vérité. Le demandeur est ainsi pris dans un processus qu’il ignore. Il ne sait pas qui il est pour l’autre. La malédiction peut être à l’œuvre.
Le fétiche efficient est pris du côté du signe et non pas du savoir.
On peut noter que dans une société réputée pour fonctionner sur le mode collectif, le fétiche est issu d’une demande individuelle. C’est le rituel qui affirme dans sa constance le caractère collectif, mais à l’intérieur des règles collectives le fétiche et son secret affirment une individualité au sein de la communauté.

A YOFF le Lébou est lié à l’esprit de la mer, aux génies de la mer. La mer a rendu des objets sensés disparaître. A-t-elle ainsi rompu la mission du fétiche ? La mer l’a rendu, il est sorti de l’eau salée, peut-être purificatrice.
Le sens du fétiche, même s’il a la forme d’une bouteille d’eau en plastique, n’est pas une bouteille à la mer. Cette dernière n’a pas d’adresse, son adresse est inconnue et même considérée comme improbable.
Le fétiche de la plage de YOFF rejoint un monde chargé de génies chers au peuple Lébou.
S’il y a un lien entre le fétiche de la tradition Lébou et le fétiche décrit par Sigmund FREUD c’est la croyance investie dans l’objet. Le fétiche est investi d’une mission liée à une croyance individuelle.
La personne qui fait sa demande au marabout est supposée avoir un problème social, collectif, individuel, relationnel peut-être inconscient. Cet objet issu d’une relation qu’on pourrait nommer transférentielle entre le marabout et le demandeur a été l’objet d’un échange d’argent contre un pouvoir supposé. On peut avancer que le don et l’échange animent cet objet et le dotent d’une mission magique.
L’objet fétiche va incarner la problématique et sa supposée résolution dans une création élaborée par un marabout, à l’extérieur de la personne du commanditaire. Cet objet externe au demandeur incarne la réalisation d’un idéal. Le lien à la communauté est préservé tout en maintenant une croyance à l’idéal du moi qui fait son chemin à l’extérieur de l’individu. L’idéologie individuelle passe par un rituel inscrit dans le collectif, ainsi la cohésion sociale est maintenue. Peut-être que cette fiction magico-religieuse comme régulateur social vient mettre un voile sur la question des interdits et des tabous. Les affects du demandeur se trouvent comme “ gelés “ à l’intérieur de l’objet fétiche, projetés en dehors vers les génies de la mer chargés de résoudre le problème dont il est question. On peut y voir sans doute un évitement du savoir de la vérité au risque de la castration dans l’organisation sociale dont il est question.
A MER COMME CRYPTE ?

Le fétiche échoué sur la plage soulève la question de savoir s’il révélera son secret. Cependant, il semble évident que le secret sorti de la mer reste intact. La mer, en tant que lieu de tous les secrets, agit comme une crypte ou un refuge, offrant un asile au dialogue entre les fétiches et les dieux. Elle accueille le secret sans en dévoiler ni en révéler le contenu.
Le fétiche apparaît comme un secret dépourvu de mots pour le transmettre ou le définir. Comme s’il y avait quelque chose qui pourrait être dit, révélé ; un secret qui, bien qu’ignoré, a toujours un destinataire. Ici, le destinataire relève du domaine mystique, la mer agissant comme une crypte, c’est-à-dire un domaine indéchiffrable.
Le fétiche, béni ou maudit, revient sur la plage sans partager quoi que ce soit du travail (liggey en wolof) qui l’a engendré. Le photographe n’est pas le destinataire du secret, mais plutôt l’illustrateur de la tension créée par le refus du fétiche de livrer son message. Se transforme-t-il en intrus ? Certains objets disparaissent d’un jour à l’autre, révèle Babacar.
Le photographe intrus s’assume comme tel et contribue à laisser échapper des bribes du secret suintant du fétiche. Est-il encore vivant, incarnant la mort ? Babacar GUEYE exprime son intérêt pour la mer en tant qu’élément intégré dans la démarche de maraboutage, bien que ses rencontres avec plusieurs marabouts n’aient pas abouti.
Le secret, semblable à un tombeau ouvert, ne livre aucun message, laissant à chacun le soin d’élaborer sa propre fiction. En évitant les a priori, une inquiétude traverse l’observateur : dans quel monde sommes-nous ? Ces objets témoins invitent à une certaine indétermination culturelle. On se demande si ces démarches laissent une trace dans l’histoire du sujet demandeur et quelle incidence elles ont sur sa vie psychique.
L’objet déchet/sacré répond à une demande en résolvant immédiatement un conflit social et individuel, mais qu’en est-il ensuite ? Au croisement de leurs chemins, Babacar GUEYE et moi avons dialogué longuement, tentant peut-être inconsciemment de percer le mystère de ces objets. Ce qui se cache dans les suintements de ces objets fétiches nous échappe à tous les deux, et le danger potentiel de l’interprétation pour les non-initiés demeure incertain.
J’ai le sentiment que nous avons démontré la possibilité d’un dialogue dans la tentative d’élaborer un sens commun. Babacar GUEYE, intellectuel reconnu muni d’un appareil photo, incarne l’Afrique en mouvement hors des sentiers traditionnels. Les objets lui rappellent les ancêtres et symbolisent la présence des génies avec leurs présumés pouvoirs sur les côtes de DAKAR. Les traditions et rituels à caractère collectif représentent des recours à des démarches individuelles auprès des marabouts, liées à la tradition et aux religions intimement mêlées.
Entre ethnologie, anthropologie, sciences des religions et psychanalyse, ce travail pourrait être considéré comme une traduction visant à comprendre et à appréhender les différences. Dans cette ouverture au dialogue, peu importe la discipline, laissons-le poursuivre sereinement son chemin.
Lydia LEDIG septembre 2021
* Maurice GODELIER « Au fondement des sociétés humaines » Albin Michel, P93